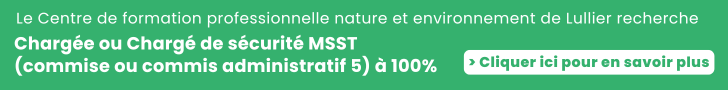Entre les lignes de fruitiers, semer de l'engrais vert aux multiples vertus
À l’origine du projet, un constat simple. Les lignes de passage entre les arbres fruitiers, ou «interrangs», sont en général une surface non productive que les agriculteurs laissent en enherbement spontané ou dans laquelle ils sèment un mélange à base de graminées gazonnantes, appelé mulching, pour occuper rapidement la surface du sol.
«Ces surfaces sont fauchées régulièrement pour éviter que les graminées ne concurrencent les arbres fruitiers et faciliter la gestion du verger», explique Robin Sonnard chargé du projet au FiBL.
Couvert végétal temporaire
Le projet OptiC Fruits, mené en partenariat avec BioVaud et avec le soutien du Canton de Vaud, propose de mieux valoriser ces surfaces en y semant un couvert végétal temporaire, plus connu sous le terme d’engrais vert. L’idée est de favoriser la biodiversité et de générer des services agro-écosystémiques.
«Avec ce projet, nous voulons optimiser les fonctionnalités de l’interrang, car il est trop peu exploité, alors qu’il occupe beaucoup de place. Ce n’est pas une révolution en soi – les engrais verts sont appliqués dans les grandes cultures depuis des années – mais comme cette pratique tend à se développer en arboriculture bio et conventionnelle, on a voulu l’analyser plus en profondeur», précise Robin Sonnard.
Des mécanismes essentiels
La notion de services agro-écosystémiques englobe plusieurs mécanismes essentiels. La présence de fleurs attire en début de saison les pollinisateurs, mais aussi des insectes qui vont lutter naturellement contre les ravageurs. «Des auxiliaires comme les coccinelles, les syrphes, les chrysopes ou d’autres hyménoptères parasitoïdes vont pouvoir proliférer et lutter contre les ravageurs, c’est ce qu’on appelle aussi la biodiversité fonctionnelle», détaille le chercheur.
Au niveau du sol, un enherbement diversifié avec de forts pouvoirs racinaires donnera une meilleure structure, permettant de créer de bonnes conditions d’infiltration pour l’eau. «Si on a des couverts assez hauts, avec des légumineuses de différentes espèces, on donne au sol de meilleurs apports de matières organiques, un facteur très important pour la vitalité des arbres et la résilience climatique, car la matière organique joue un rôle d’éponge», poursuit le scientifique.
Biodiversité gagnante
La biodiversité du sous-sol y gagne aussi. «En grattant la terre, on trouve une multitude d’insectes et des vers de terre, dont la présence garantit des échanges de qualité entre les insectes et la végétation.»
Un couvert végétal est également synonyme de paillage. «Quand on a semé un couvert, on ne va pas le faucher, mais passer un rouleau pour qu’il reste sur place», explique l’expert. La végétation peut ainsi se dégrader lentement et apporter plus équitablement les nutriments et la matière organique au sol. Le paillage a également une fonction de protection contre la sécheresse, la végétation ayant la capacité de maintenir l’humidité au sol.
Dispositif détaillé
Les chercheurs ont mis en place un dispositif d’essai détaillé, avec des prélèvements et des analyses répartis sur deux ans, pour évaluer quel type de couvert a le meilleur impact sur la vie du sol. Quatre mélanges différents ont été testés sur une parcelle de jeunes pommiers appartenant à David Vulliemin, agriculteur bio à Pomy.
La première variante utilisée dans l’essai, qui était aussi la variante de référence, est le mulching. La deuxième est le mélange Wolff, un mélange de semences bios qui a la particularité d’avoir deux types de plantes: des espèces annuelles qui font beaucoup de biomasse nutritive pour le sol, mais qui sèchent après moins d’une année, et des espèces vivaces qui ont été intégrées pour prendre le relais des annuelles.
Des auxiliaires vont pouvoir proliférer et lutter contre les ravageurs.
La troisième variante est un mélange à base de légumineuses, Legu Fit, qui est souvent utilisé dans les grandes cultures et comprend des espèces annuelles, mais en nombre limité. Après avoir été semé, il fait une très grosse biomasse, avant d’être remplacé par des graminées. Dernière variante, le mélange Viti Fit été, un mélange de plantes annuelles créé par le FiBL pour la viticulture et adapté pour l’essai en y ajoutant des espèces pérennes censées prendre le relais.
Une approche gagnant-gagnant
Les résultats intermédiaires ont été obtenus à l’aide d’une méthode spécifique qui permet d’estimer les quantités d’éléments restitués au sol par les couverts végétaux. Pour chaque variante de semis, les chercheurs ont découpé la végétation sur un mètre carré, avant de la trier et de la peser espèce par espèce. Les données ont ensuite été rentrées dans un logiciel capable d’estimer les reliquats en azote, en phosphore, en potassium et l’apport en matière organique à la parcelle.
C’est le mélange Legu Fit qui a restitué le plus de reliquats, un résultat qui n’étonne qu’à moitié l’expert: «Il fait une telle biomasse la première année que ses reliquats sont les meilleurs, même si l’année d’après, il n’a plus d’effet bénéfique.» Le mélange mulching est la moins bonne de toutes les variantes avec moitié moins d’azote et de phosphore et trois fois moins de matières organiques. Wolff se classe en deuxième place et Viti Fit été en troisième. Une nouvelle analyse des reliquats va être réalisée en cours d’année à l’aide cette fois d’analyses de sol.
David Vulliemin, qui a contribué à la mise sur pied de l’essai, n’a aucun doute sur la pertinence de l’approche préconisée par le FiBL. «Elle me permet d’amener de la biodiversité tout en gardant des objectifs de production quasi équivalents à un verger standard. La biodiversité fonctionnelle a plein d’avantages: en laissant une zone intouchée, on crée par exemple des abris et de la nourriture pour les syrphes, dont les larves consomment beaucoup de pucerons. Et comme je fais moins d’entretien, je fais aussi des économies», se réjouit l’arboriculteur.