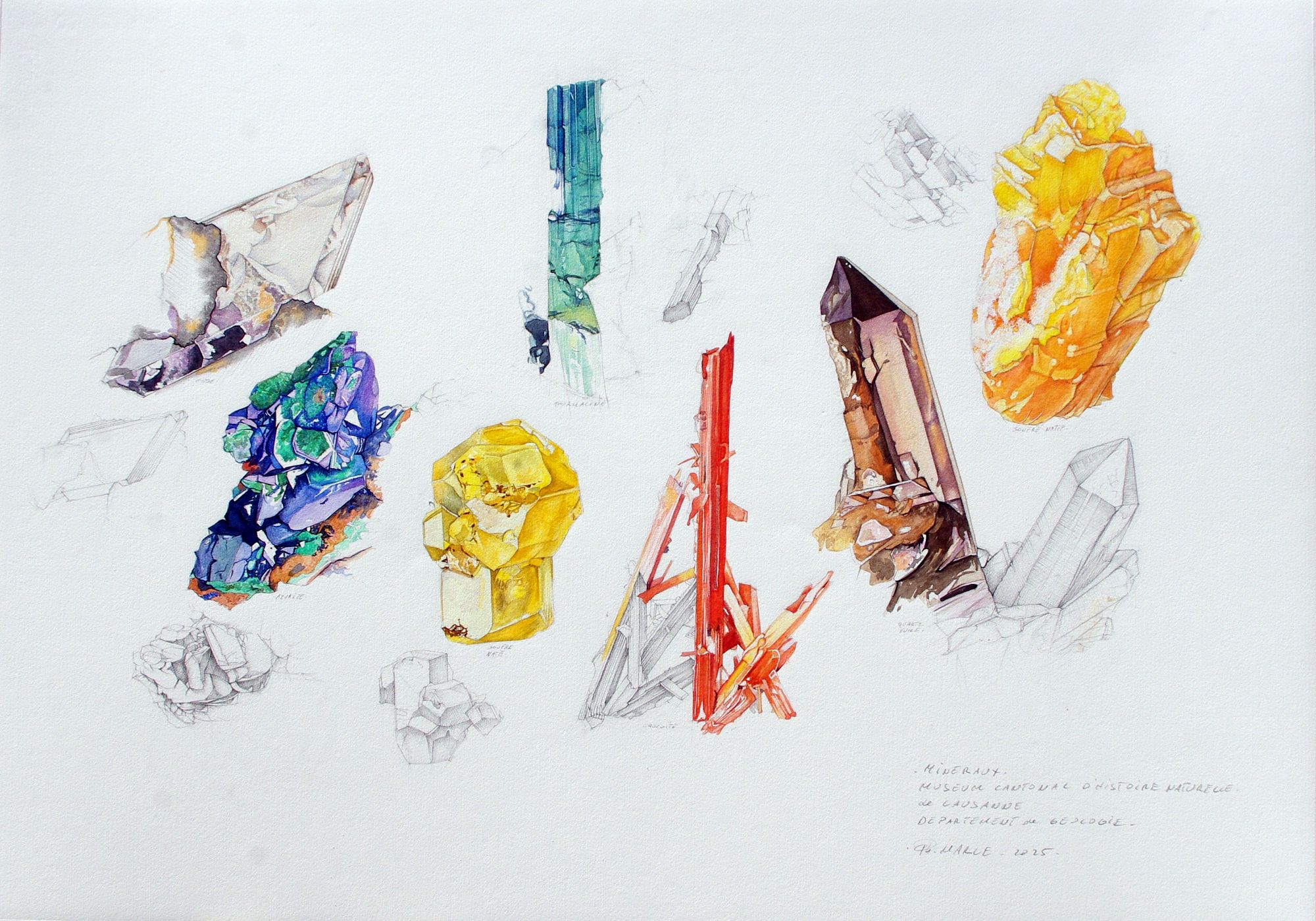Un atlas inédit réunit les voix des derniers Jurassiens qui «djâsent» en patois
Ils s’appellent Francis, Étienne et Denise, viennent de Montenol, Courrendlin ou encore Delémont, et sont âgés de plus de 80 ans. Ces Jurassiens sont parmi les derniers du canton à parler couramment le patois de leur région.
Témoins précieux de ces parlers menacés de disparition, leurs voix sont désormais conservées dans l’Atlas sonore des patois du Jura, mis en ligne le mois dernier par l’Université de Neuchâtel, avec le soutien de l’Office fédéral de la culture.
Un travail inédit
Un tel travail n’avait jamais été effectué dans la région. Des données avaient été récoltées au XXe siècle, mais on ne disposait pas des bandes sonores. En Suisse, les patois jurassiens sont sous-documentés par rapport à ceux du Valais, car on les considérait comme moins exotiques en raison de leur ressemblance avec l’ancien français.
Pourtant, ils sont tout aussi riches, assure Mathieu Avanzi, professeur de dialectologie qui a coordonné le projet. D’après les statistiques fédérales de 2000, seulement 2 à 10 % des Jurassiens le parlaient dans les communes recensées. Ces chiffres ont certainement baissé depuis, mais il n’existe plus de données. Il y avait urgence à recueillir la parole des derniers locuteurs.
40 entretiens menés
Pour ce faire, des entretiens ont été menés auprès d’une quarantaine de personnes, grâce à une enquête de voisinage. Pour commencer, des amicales ont été contactées. Puis il a fallu sonner aux portes, aller de ferme en ferme et faire circuler l’information, raconte le linguiste, dont les trois assistants ont sillonné le territoire. Le profil le plus courant des interviewés : des hommes âgés de 85 ans en moyenne, souvent agriculteurs, qui parlaient patois avec leurs parents. Il y a moins de femmes, probablement parce qu’elles quittaient leur village plus tôt pour rejoindre leur mari.
Aucun de ces locuteurs n’a transmis cette langue à ses enfants. À l’époque, parler patois était mal vu, au contraire du français, associé à la modernité et à la réussite sociale. D’autres témoins ont décidé de l’apprendre sur le tard, en s’inscrivant à des activités culturelles comme le théâtre.
Apprendre les bases
Bonjour: bondjò, bondjoué
Bonsoir (à vous): bonsoi (en vos)
Comment ça va?: è vait?
Je vais bien: i vais bïn
Merci: méchi
Parler: djâsaie
Aujourd’hui: âdj’d’heû
Au revoir: en lai r’voyûre
Il fait chaud: è fait tchâd
Il va pleuvoir: è veut pieûvre
Comparer les parlers entre communes
« Il fait chaud aujourd’hui. Je vais au bistrot. Le bœuf a des cornes. » À chaque rencontre, les contributeurs ont dû traduire des phrases types tirées des enquêtes de 1950 et décrire des images. Le but: comparer les patois des différentes communes, façonnés par des siècles d’histoire locale.
Pour l’instant, nonante localités ont été visitées. Il y a beaucoup de locuteurs en Ajoie. En revanche, ils sont rares dans la vallée de Delémont, qui s’est industrialisée. Dans les Franches-Montagnes, il n’y en a presque plus, regrette le spécialiste, qui note que ces parlers régionaux s’uniformisent avec le temps.
Une carte en libre accès
En libre accès sur le site, une carte permet de naviguer de village en village pour écouter les patoisants. Il est aussi possible de rechercher des mots spécifiques pour connaître leurs traductions, grâce à des fichiers sonores. Chaque terme a été transcrit en alphabet phonétique. Ce fut un travail de longue haleine, explique Mathieu Avanzi.
Un portrait audio et photo de chaque locuteur est disponible, ainsi qu’un onglet « anecdotes d’entretien » rassemblant récits de travaux dans les champs, blagues, fables et chansons. Ce sont des témoignages précieux d’un mode de vie et d’une identité en mutation. Au début, les villageois étaient timides ou réticents. Puis les langues se sont déliées. Souvent, on ne pouvait plus partir, sourit-il. Ce sont des rencontres inoubliables.
Beaucoup de retours positifs
Depuis la mise en ligne, l’équipe neuchâteloise a reçu de nombreux retours positifs. Des personnes ont demandé à être enregistrées. Une dame a même envoyé un CD. Mais surtout, les remerciements affluent. Le fait qu’une université s’intéresse à un langage autrefois stigmatisé lui rend ses lettres de noblesse, estime le dialectologue. Les enquêtes se poursuivront en 2026 afin de couvrir l’ensemble du territoire, à mi-chemin entre la recherche scientifique et la sauvegarde du patrimoine immatériel.
Alors qu’un projet similaire va être mené dans les Grisons, l’Office fédéral de la culture publiera à la fin de l’année une plateforme web intercantonale pour faciliter l’apprentissage des patois suisses, avec des exercices d’initiation et des vidéos, notamment destinées aux enfants. Il est important de promouvoir ce savoir auprès des jeunes, car les patois jouent un rôle identitaire majeur. Ils permettent de préserver la richesse du patrimoine face à un monde qui s’uniformise, tout en célébrant les différences. C’est un devoir de mémoire, conclut le chercheur.
+ D’infos
aspaju.unine.ch
Une langue bien vivante
Si le patois était le langage usuel de la majorité des Jurassiens durant des siècles, son déclin a commencé dès le XIXe siècle, suivi d’une disparition progressive dans l’usage public. Parallèlement, ce phénomène s’est accompagné d’un intérêt croissant pour cette langue, notamment dans le domaine artistique avec des pièces de théâtre et des chorales. Aujourd’hui, plusieurs amicales promeuvent son usage, notamment lors de rencontres mensuelles appelées « djaseries » (bavardage). Des chroniques publiées dans les journaux et diffusées à la radio lui rendent également hommage.
À l’école primaire des Breuleux, l’enseignante Agnès Surdez propose depuis 1992 un cours facultatif pour les élèves, avec succès. La plupart sont curieux, car ils ont entendu leurs grands-parents le parler. Il y a en moyenne quinze participants par année. Pour moi, c’est un petit miracle, confie-t-elle. Chaque année, une pièce de théâtre est montée par sa classe, accompagnée de chansons. Elle sera jouée à Lajoux en mars prochain.