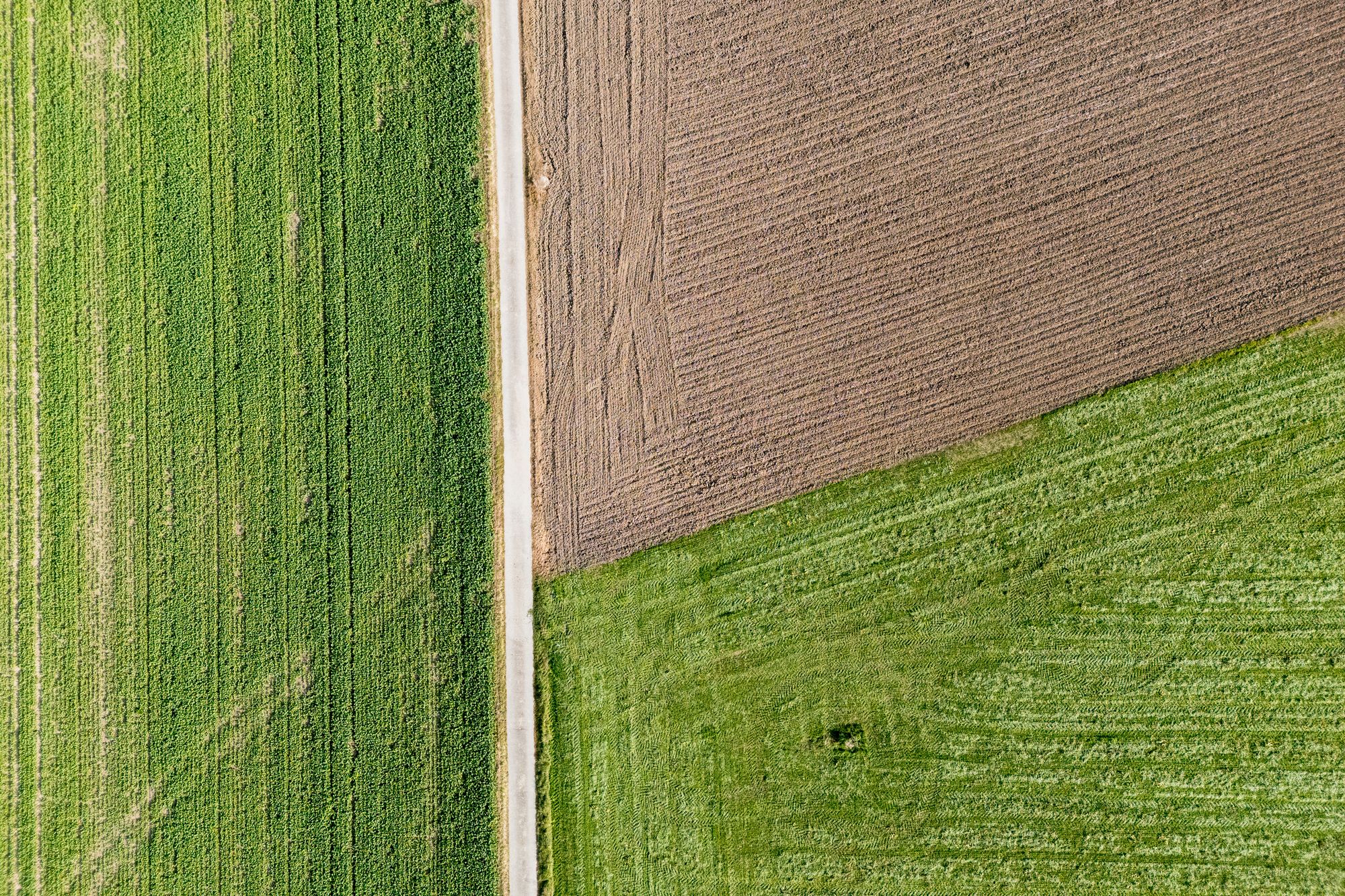AgroImpact: une alliance inédite pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture suisse
Sur les coteaux de Daillens (VD), Pascal et Quentin Francillon observent leurs champs. Le père et le fils, qui gèrent ensemble ce domaine familial de 100 hectares situé sur les hauteurs de Lausanne, figurent parmi les près de 300 exploitants participant à la première phase du projet AgroImpact. En repensant leur manière de travailler les sols, en augmentant les apports en compost ou en adaptant leur stratégie de semis, ils prévoient d’abaisser le bilan carbone de la ferme de 71% en six ans seulement.
Mesurer avant d’agir
Créée fin 2023, l’association intercantonale AgroImpact réunit autour d’une même table des agriculteurs, le WWF, mais aussi la multinationale Nestlé ou le distributeur Lidl. Une alliance inédite, lancée par les chambres d’agriculture romandes avec l’appui du Canton de Vaud, pour répondre à un défi urgent: réduire l’empreinte carbone des fermes. «La politique agricole seule ne suffit plus, il faut impliquer le marché», estime Aude Jarabo, directrice d’AgroImpact.
Entre la réduction des émissions et l’optimisation du stockage dans les sols, nous devrions réduire notre bilan carbone de 71%.
Chaque exploitation volontaire commence par établir un bilan carbone complet, selon la méthodologie ClimaCert. Le calcul intègre non seulement les émissions (machines, engrais, bétail), mais aussi la capacité des sols à stocker du carbone. De quoi révéler des marges de progrès parfois insoupçonnées. «Quand AgroImpact est venu effectuer des mesures sur mon domaine, on a découvert que mes sols captaient une partie du CO2, raconte ainsi Yann Morel, agriculteur et viticulteur à Arnex-sur-Orbe (VD). Je ne laboure plus mes terres depuis vingt ans, le sol est donc riche en humus et capable de stocker davantage de carbone qu’il n’en émet. Il reste à travailler sur les émissions liées aux machines.»
Une plateforme innovante
Une fois le diagnostic établi, rien n’est imposé: l’agriculteur choisit, avec un conseiller cantonal, les mesures qui lui conviennent. «C’est essentiel de garder une totale liberté», souligne Thierry Salzmann, agriculteur à Bavois. Son objectif est de réduire de 95% l’empreinte de sa ferme en six ans grâce à plusieurs actions ciblées.
A lire aussi
Notre interview de Daniel Imhof, Responsable des affaires agricoles de Nestlé Suisse et architecte du projet AgroImpact: «La pérennité d’une entreprise alimentaire est indissociable de celle de l’agriculture qui lui fournit des matières premières»
Pour encourager le changement, AgroImpact a mis sur pied une plateforme innovante. «Si la plateforme AgroImpact est si novatrice, c’est qu’elle ne repose pas sur un mécanisme de compensation, explique la directrice de l’association. Seuls les acteurs qui sont responsables de manière directe ou indirecte des émissions de gaz à effet de serre sont concernés par les réductions de carbone générées.» C’est ce qu’on appelle l’insetting, par opposition à la compensation carbone traditionnelle (offsetting) qui finance des projets externes sans lien direct avec les opérations de l’entreprise. C’est en partie ce qui a motivé le WWF Suisse à soutenir AgroImpact (lire l’interview ci-contre).
Corollaire de cette approche, les primes climat: les industriels et distributeurs qui achètent les produits rémunèrent directement les efforts de décarbonation en versant des primes aux agriculteurs engagés. Suivant le principe de gouvernance partagée qui préside à son action, AgroImpact a constitué un groupe d’acteurs chargé de fixer le prix d’un kilo de CO2 et de rétribuer équitablement les efforts. Aude Jarabo détaille le processus: «Le prix du carbone se fixe pour un temps long, celui nécessaire au changement sur les fermes, en concertation, pour qu’il soit assez attractif pour ceux qui font les efforts et également pour ceux qui les rétribuent. Nous sommes donc allés au-delà de la logique de l’offre et de la demande en établissant ce prix via une commission représentative.»
L’empreinte carbone d’un produit devient un critère aussi important que sa teneur en protéines ou son origine.
Actuellement, la plateforme alloue en moyenne 1,3 centime par kilo de lait ou 34 francs par tonne de blé aux producteurs engagés. Les sommes engagées sur six ans représentent 4,8 millions de francs, pour 16 114 tonnes de produits certifiés bas carbone. Avec les produits inclus aujourd’hui dans la plateforme de financement, les exploitations qui se sont engagées perçoivent en moyenne près de 5000 francs de prime climat par an, selon AgroImpact.
Des données fiables sur l’empreinte carbone des produits
Aux grandes entreprises alimentaires, AgroImpact fournit ce dont elles ont cruellement besoin: des données primaires fiables sur l’empreinte carbone des produits alimentaires. Car leurs engagements climatiques leur imposent de réduire de 30% leurs émissions d’ici à 2030. «Le Product Carbon Footprint devient un critère de qualité aussi important que la teneur en protéines ou l’origine», relève Aude Jarabo. Au 1er septembre, 165 exploitations vaudoises, près d’une cinquantaine jurassiennes et bernoises et une soixantaine entre Genève, Fribourg et Neuchâtel participent déjà au programme. L’objectif est d’atteindre 17 000 fermes d’ici à 2030, puis 25 000 en 2050.
Un modèle d’avenir
Sur le terrain, la démarche séduit par son pragmatisme. Pas de recette universelle, pas de contrainte, juste un accompagnement basé sur des données scientifiques et une rémunération concrète des efforts. «Je vois AgroImpact comme une assurance récolte climatique», confie Yann Morel. Au-delà des chiffres, l’initiative incarne un changement culturel. Voir un paysan, une ONG écologiste et une multinationale travailler ensemble peut surprendre. «Cette opposition entre nous est exagérée, estime Benoît Stadelmann, responsable Community and Project for Nature au sein du WWF. Nous avons un intérêt commun: des sols vivants.»
L’approche d’AgroImpact en Romandie ouvre des perspectives prometteuses: «Ce qui change c’est qu’il ne s’agit pas de budget classique d’achat de produits agricoles pour les entreprises mais de budget d’investissement, note la directrice de l’association. Elles investissent auprès de leurs fournisseurs pour s’assurer d’avoir demain des matières premières. Ce qui nous permet de sortir des mécanismes de négociation de prix souvent bloqués L’expertise scientifique, indispensable, est également présente à chaque étape.»
La conseillère d’État vaudoise Valérie Dittli se réjouit, elle aussi, du potentiel de cette initiative et ébauche ce que pourrait être son rôle dans le cadre de la future politique agricole: «Il s’agit d’un modèle totalement novateur pour favoriser la transition agricole. S’il prouve son efficacité, il se révélera effectivement complémentaire au système actuel des paiements directs, voire représentera une alternative crédible à celui-ci dans le cadre de la future Politique Agricole 2030.»
+ d’infos agroimpact.ch
Questions à Thomas Vellacott, Directeur général du WWF Suisse
Quel rôle joue le WWF au sein du comité d’AgroImpact?
En tant qu’ONG environnementale, notre rôle est de garantir que les processus et méthodologies soient scientifiquement solides, un rôle que nous partageons avec les membres du collège scientifique d’AgroImpact. L’objectif est d’assurer la traçabilité et la transparence des flux entre les partenaires, qu’il s’agisse de produits, de primes ou de carbone. Cet aspect est central pour prévenir tout risque d’accusation de greenwashing. Le WWF s’engage également à faire en sorte que la transition agricole portée par AgroImpact ne se limite pas aux objectifs climatiques, mais intègre la dimension de la biodiversité. En outre, nous coordonnons, avec les acteurs impliqués et un groupe d’experts, le développement d’un indicateur «biodiversité» qui viendra compléter l’indicateur «climat» actuellement en vigueur.
Voir Nestlé et le WWF s’allier autour d’un même projet, cela peut surprendre…
Oui, et c’est justement ce qui fait la force d’AgroImpact, qui suscite déjà un grand intérêt à l’échelle internationale. Lorsqu’un acteur industriel de la taille de Nestlé décide de s’engager concrètement pour réduire ses émissions, une démarche ambitieuse et complexe, compte tenu du grand nombre d’agriculteurs avec lesquels il collabore, le potentiel d’impact est considérable. Il est important de saisir ces opportunités et d’accompagner ces processus pour garantir que les résultats soient à la hauteur des ambitions et puissent servir de modèle. De leur côté, les producteurs sont intéressés à recevoir un accompagnement et un soutien dans leur transition vers des pratiques plus durables. Chaque collège et chaque membre d’AgroImpact ont un rôle à jouer et contribuent au succès de cette transformation. Le WWF, pour sa part, apporte son expertise en matière de préservation de la nature et d’utilisation durable des ressources, et investit également des ressources importantes dans le projet.
Au premier abord, on n’attend pas le WWF sur la question agricole. Quelle place occupe-t-elle dans votre programme?
L’histoire du WWF est intimement liée à la protection de la nature. Très vite, il est toutefois apparu qu’on ne peut pas protéger une espèce menacée en se concentrant uniquement sur elle. Il faut comprendre l’ensemble du système dans lequel elle évolue: son environnement, les interactions qui la soutiennent ou la fragilisent. Dans ce système, l’agriculture occupe une place centrale. Elle façonne une grande partie de nos paysages et influence directement la qualité des habitats naturels. C’est pourquoi il est essentiel de travailler main dans la main avec le monde agricole pour concilier production alimentaire et préservation de la biodiversité.
+ d’infos wwf.ch