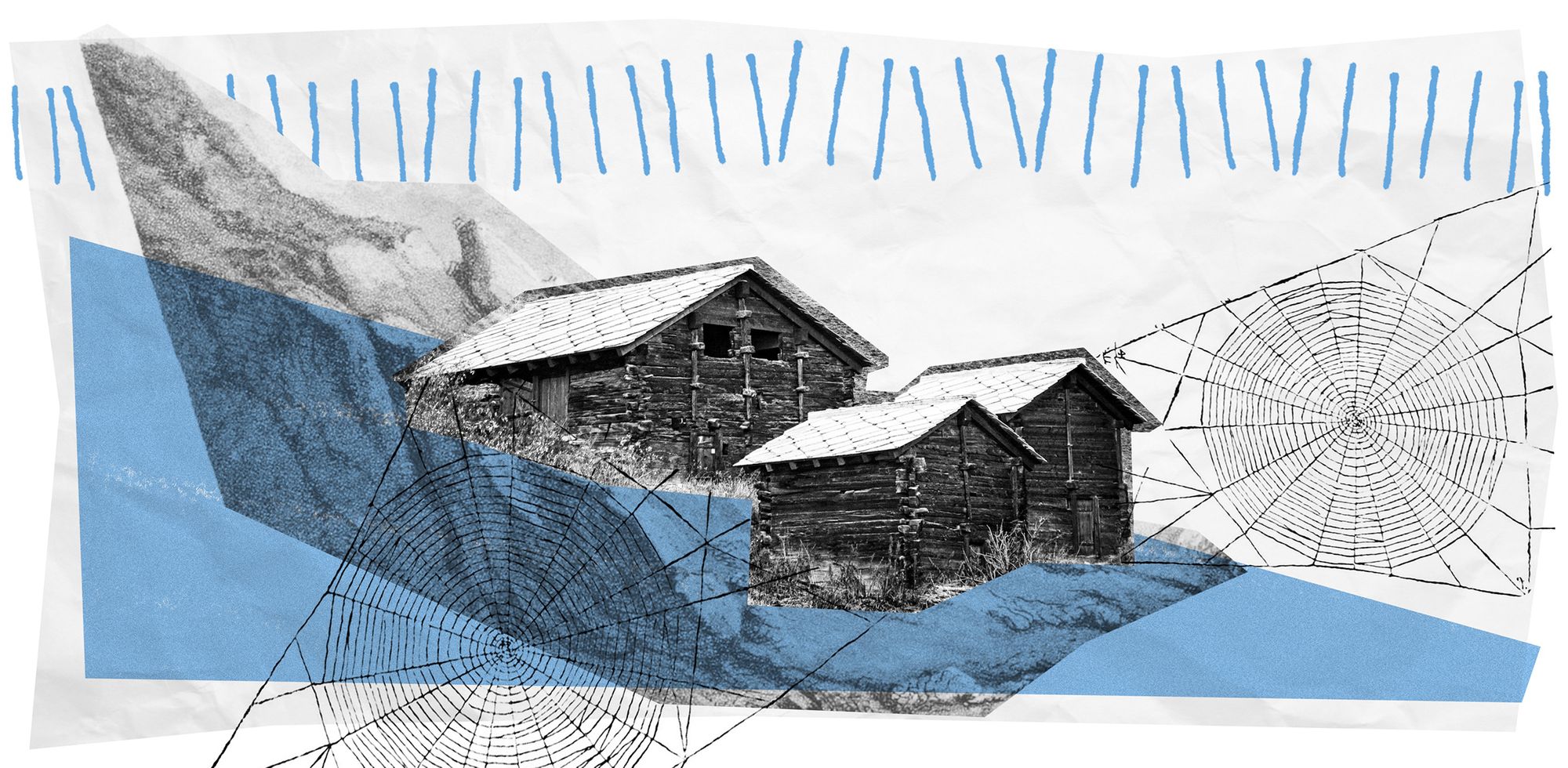Le mythique chalet d'alpage est-il à un tournant de son existence?
Épisodes de sécheresse, pression des grands prédateurs, manque de main-d’œuvre: sur les alpages, les causes de découragement ne manquent pas. Vivre l’estivage dans des conditions spartiates est un sacerdoce et les circonstances actuelles ne sont pas sans poser de nombreuses questions quant à l’avenir d’une tradition inscrite l’an dernier au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. En vingt ans, le nombre d’estivages en Suisse a ainsi diminué de près de 900, pour atteindre 6574 en 2022.
Parallèlement à cette érosion, celle du cheptel laitier en Suisse se fait aussi sentir: le nombre de vaches laitières a atteint un seuil historiquement bas en 2023 à 515 000 bêtes, alors que la production de viande bovine a légèrement augmenté, ces dernières années. Cette évolution ajoute une pression supplémentaire sur les chalets: sur les pâturages occupés par des vaches-mères, les bâtiments ne sont plus utilisés pour la production de fromage et sont délaissés.
Investissements conséquents
Ce modèle agricole est-il encore suffisamment rentable pour se maintenir? Avec 514 alpages recensés dont 300 dans la partie romande, le Valais est au centre de ce questionnement. «C’est en effet un défi lors de la remise d’une exploitation d’alpage, réagit Jean-Louis Monnet, responsable d’arrondissement au Service valaisan de l’agriculture. Nous constatons toutefois que cette activité n’est pas en baisse dans le canton. En dix ans, nous avons observé une disparition de l’ordre du 10% du nombre d’alpages, principalement due à des regroupements.»
L’entretien des chalets et des accès est cependant lourd. Au Vieux-Pays, «les alpages et les chalets appartiennent le plus souvent aux bourgeoisies, à des consortages et parfois à des personnes privées», détaille Jean-Louis Monnet. Dans le seul district de Monthey, on dénombre quelque 120 chalets, dont une bonne part dans la vallée d’Illiez. Le président de la Commune et de la Bourgeoisie de Val-d’Illiez Ismaël Perrin peut témoigner du poids que représente leur entretien.
Projet à 1,75 million de francs
La Bourgeoisie rénove actuellement à Chaupalin l’un de ses cinq chalets, pour le maintenir aux normes, mais également pour permettre de poursuivre l’exploitation touristique du gîte qui y est aménagé. Il s’agit d’un projet à 1,75 million de francs. «Pendant de nombreuses années, un petit entretien courant a été réalisé, mais les investissements ont manqué et un retard s’est creusé. C’est un défi de maintenir ces structures, dont la majorité chez nous appartient à des privés: cela nécessite d’avoir des propriétaires qui sont capables d’investir», souligne Ismaël Perrin.
Malgré tout, le secteur se maintient. Dans le canton, 160 alpages produisent du lait destiné à la fabrication de fromage. Le succès de l’AOP Raclette du Valais – la cinquième du pays selon les volumes produits – n’est pas étranger à cette bonne santé. D’autres facteurs y contribuent. «En Valais, l’accessibilité dans les vallées latérales par le réseau routier est relativement bonne, voire excellente, observe Jean-Louis Monnet. Et les estivages constituent en outre un revenu complémentaire intéressant pour les exploitations de base à l’année et permettent l’obtention de contributions publiques.»
Preuve de sa volonté de conserver cette activité, moteur de l’entretien des paysages alpestres, la Confédération verse annuellement plus de 530 millions de francs de paiements directs pour la contribution au paysage cultivé, dont plus de 90% sont consacrés à la mise en estivage du bétail, au maintien d’un paysage ouvert ou à l’entretien des surfaces en pente. Sur cette somme, près de 400 millions ont été alloués aux régions de montagne.