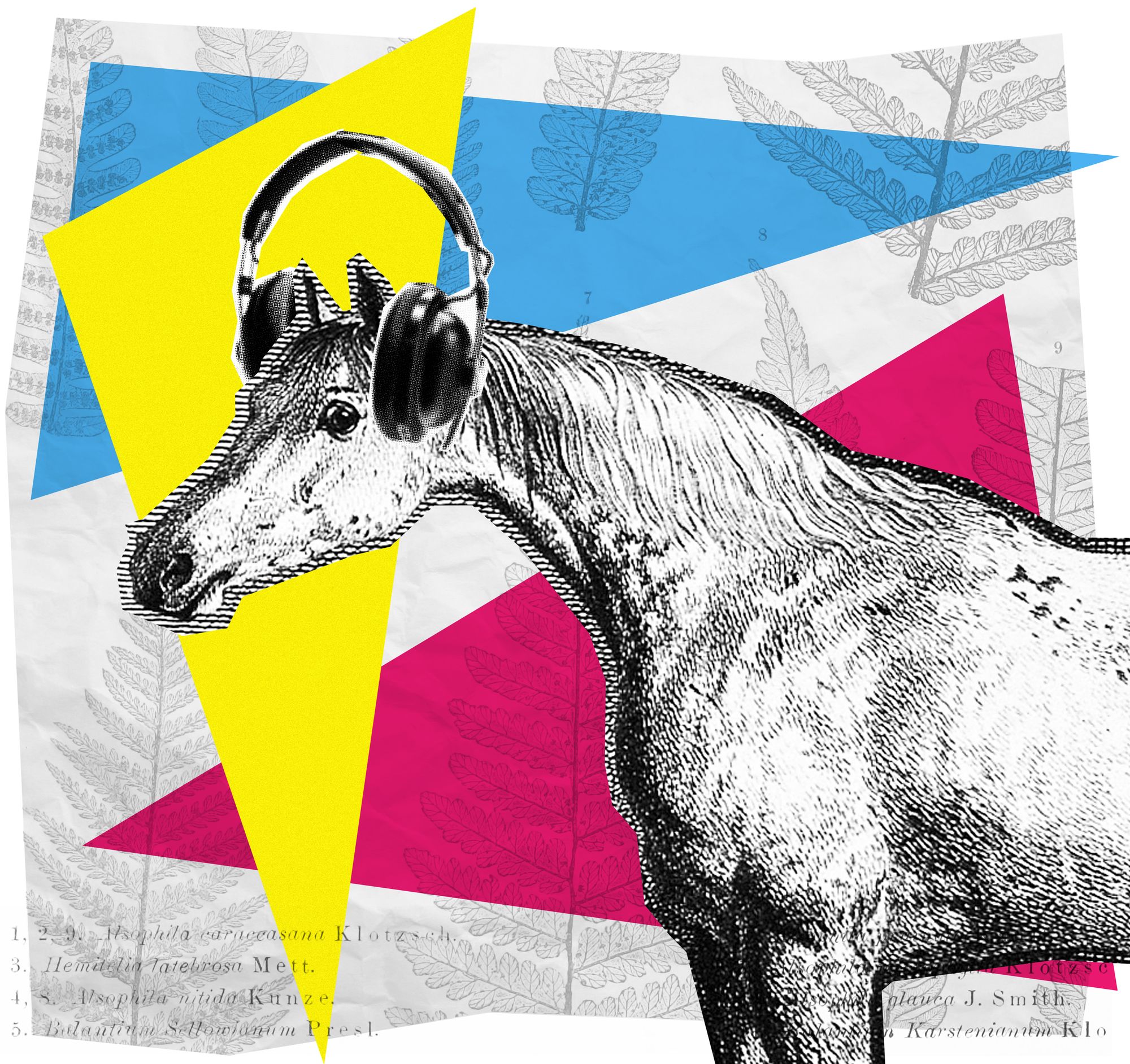Les bruyères, discrètes reines de l'hiver toujours à nos côtés
Pour une culture à long terme au jardin et sur le balcon, quatre espèces de bruyères, chacune se déclinant en variétés plus ou moins nombreuses, à fleurs blanches, roses ou pourprées, sortent du lot: la bruyère carnée (Erica carnea), indigène, et son hybride la bruyère de Darley, la bruyère vagabonde (Erica vagans), autrefois présente dans le canton de Genève, et enfin la callune (Calluna vulgaris), elle aussi indigène.
La dernière nommée se distingue des autres par ses feuilles en écailles (et non en aiguilles) et ses fleurs étoilées (et non en grelots). C’est la bruyère d’automne par excellence, et celle qui offre le plus de diversité, avec aujourd’hui des feuillages très colorés. Mais elle n’aime guère le calcaire – quand la bruyère vagabonde, plutôt estivale, en tolère un peu, et les deux autres, hivernalo-printanières, le supportent.
Une grande famille
C’est une famille relativement importante que celles des Ericacées, avec une centaine de genres et plus de 1300 espèces. La flore suisse n’en compte qu’un petit échantillonnage: une douzaine de genres et deux douzaines d’espèces, formant pour la plupart des sous-arbrisseaux ou des arbustes nains, et préférant l’altitude quand il ne s’agit pas de plantes des tourbières – les deux n’étant pas incompatibles.
Si vous randonnez en montagne, vous en avez forcément admiré en fleurs, ou dégusté leurs fruits: les rhododendrons, les airelles (dont le myrtillier) et les raisins d’ours sont des Ericacées. Ce sont pourtant des plantes plus secrètes qui ont servi à baptiser la famille: les bruyères, Erica de leur nom de genre. Discrètes, mais bien présentes dans l’histoire des hommes…
Remède contre les cystites
Les feuilles de la bruyère des landes (Erica cinerea), mais aussi d’autres Ericacées, notamment le raisin d’ours, les canneberges, l’arbousier ou encore le myrtillier, toutes plantes à fleurs en forme de grelot (ou de lanterne, selon les interprétations), sont utilisées en médecine naturelle pour lutter contre les cystites.
Elles doivent leurs propriétés antibiotiques et diurétiques à une molécule, l’arbutine (qui tire son nom d’Arbutus unedo, l’arbousier méditerranéen), laquelle semble aussi pouvoir atténuer les problèmes d’hyperpigmentation de la peau. Les tiges fleuries de la callune également sont utilisées en phytothérapie contre les infections urinaires et les problèmes de prostate.
Un goût de miel et de tabac
La bruyère arborescente, Erica arborea, est originaire des rives de la Méditerranée et se rencontre aussi au Portugal. Au sud de la France, elle peut atteindre deux ou trois mètres de haut et éclôt dès la fin de l’hiver ses petites fleurs blanches très parfumées – appréciées des insectes, comme celles de la plupart de ses cousines, et notamment des abeilles: on en tire un miel roux, crémeux, aux arômes de sapin et de caramel.
En montagne, en revanche, le «miel de bruyère» provient surtout de la callune; épais, orangé, il a un goût marqué et un peu âpre, rappelant le miel de châtaignier. Mais les fumeurs aussi apprécient la bruyère, pour le bois léger et résistant de ses «bulbes», qui font d’excellentes pipes. Là, c’est uniquement Erica arborea qui est mise à contribution.
Des origines anciennes
Comme Violette ou Rosa, Erica semble être un prénom végétalo-féminin. Mais si le nom de genre Erica désignait déjà la bruyère chez les Romains, une autre étymologie le fait dériver du vieux norrois (la langue scandinave médiévale), avec le sens de «souveraine éternelle». Le mot «bruyère», lui, est d’origine gauloise (brucus désignant la plante, mais aussi la lande), tandis que «callune» vient du grec, avec le sens de rendre beau, mais aussi de nettoyer.
Ce n’est pourtant pas elle, mais la brande (Erica scoparia) qui était la bruyère à balai! Au chapitre des curiosités, la palette des callunes s’élargit d’année en année, avec des feuillages orangés, limette, grenat, argentés, presque noirs. En revanche, leurs fleurs ne se déclinent toujours que du blanc au carmin: si vous en trouvez des bleues, jaunes, mauves, rouge vif ou vert pétant, elles sont… peintes!
Comment les cultiver?
Si on les confond facilement entre elles, les bruyères ont des exigences diverses. Si la plupart se plaisent à mi-ombre ou au soleil et préfèrent un sol plutôt acide, frais mais drainé, la bruyère carnée supporte le calcaire et, comme la vagabonde, une certaine sécheresse.
Sans surprise, hors microclimats, la plupart des espèces de Méditerranée ou d’Afrique du Sud ne tolèrent pas (encore) nos hivers, qu’il s’agisse des bruyères à grandes fleurs, de la haute Erica arborea ou d’Erica gracilis, la star de l’automne; même certains cultivars de Calluna et la bruyère d’Irlande (Daboecia) peuvent se montrer fragiles au froid. Pour les conserver d’une année sur l’autre, il vaut mieux tenter de les hiverner à l’abri, même s’il s’avère souvent délicat de les conserver en pot.